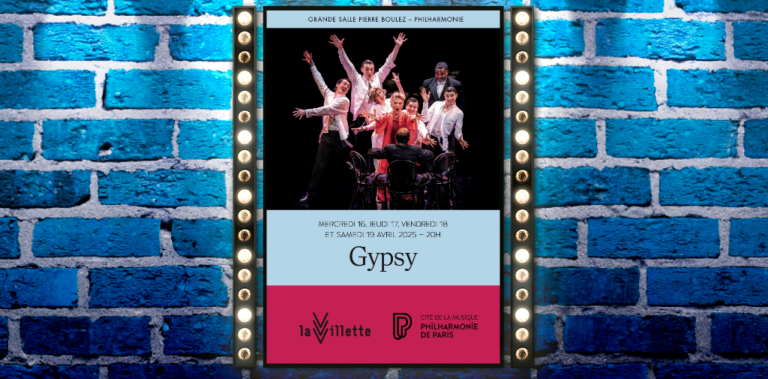[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_text]
20 ans, la Guerre ?
Yvonne, Rose-Marie, Solange : recluses dans la cave d’une maison à Caen, elles rêvent d’amour et de liberté, elles qui n’ont connu que la guerre depuis leurs 16 ans. Avec le débarquement, l’espoir renaît, mais les activités résistantes de Petit René (cousin d’Yvonne) les contraignent à fuir en zone libre. L’insouciante Rose-Marie laisse derrière elle Hans, le soldat allemand qu’elle aime ; Solange s’imagine en leader de l’émancipation féminine ; Yvonne veille sur ce petit monde comme une mère de substitution. Peu avant la libération, elle s’éprendra de Willy, un GI débarqué sur les plages de sa région d’origine. Hans sera fait prisonnier par les alliés aux portes de Paris.
À quelques (infimes) détails près, voici toute l’intrigue d’Un Été 44 et ses protagonistes. Vous espériez une grande fresque historique haletante et passionnante revenant sur les trois mois qui ont changé le destin de la France et mis fin à la Seconde Guerre Mondiale ? Vous ne l’aurez pas.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_image id= »10591″ size= »full » link_type= »custom_url » link= »# » target= »false » caption= »true » align= »center » margin= »15,25,none,none »]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_row_inner]
[mp_span_inner col= »12″]
[mp_text]
Sur un livret désespérément creux et sans le moindre enjeu, on assiste donc à une succession de scènes dispensables, habitées tant bien que mal par une bande d’adolescents sans gravité. Jamais on ne perçoit l’urgence de la guerre. Jamais l’émotion, la terreur, l’horreur, ni la douleur ne poignent.
Tout est survolé, à peine évoqué (où sont les adultes ? les juifs ? les batailles féroces ?) comme s’il ne s’agissait que d’une case à cocher dans la liste des sujets à inclure au spectacle.
Le terrible joug de l’Allemagne nazie sur la France occupée a pour tout visage un minable traducteur, poète et romantique.
L’horreur des affrontements sur les plages de la Manche est symbolisée par les allées et venues solitaires d’un soldat américain perdu dans ce « fucking bocage » (sic).
La résistance, ce n’est qu’un gamin pas très hardi qui fait passer des petits messages à bicyclette.
Certains numéros abordent néanmoins des anecdotes et aspects peu connus de la Seconde Guerre Mondiale : les Rochambelles, les FFI, le rôle des soldats Québécois…
Mais la « pièce » ne jouit d’aucune dramaturgie, d’aucune surprise, et l’on s’ennuie ferme devant une succession de tableaux relevant d’avantage du spectacle son et lumières que de la comédie musicale. Les chansons solos, censées nous exposer chacun des personnages (sans exception), s’enchaînent lourdement sans que jamais ne se dessine la moindre action. Dans une galerie de personnages réduite, près de la moitié n’a aucun intérêt dramatique (c’est le cas criant de l’Allemand, l’Américain, et du frère expatrié d’une des trois héroïnes : ce dernier n’apparaît qu’à la proue d’un navire de guerre écossais, guitare à la main, pour chanter l’amour de sa belle restée à Édimbourg…).
[/mp_text]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner]
[mp_span_inner col= »12″]
[mp_image id= »10592″ size= »full » link_type= »custom_url » link= »# » target= »false » caption= »true » align= »center » margin= »15,25,none,none »]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_text]
Y a-t-il un metteur en scène dans le navire ?
Comme pour sauver une narration famélique, on a droit aux interventions vidéos de Marisa Berenson, presque touchante en dame attelée à relire le journal intime d’une des trois ados. Sans doute pour rassurer un public plus habitué aux salles obscures qu’au théâtre, on se retrouve devant des pastilles filmées qui nous laissent circonspect. En prenant le parti de ne pas intégrer ce personnage en « live », le spectacle nous prive du seul ressort théâtral sur lequel il pouvait reposer.
Pire encore : il ne se passe strictement rien sur le plateau. On aimerait parler de « mise en scène », mais ce serait faire injure à la discipline.
Les tableaux restent désespérément statiques, dénués de la moindre intention créative et de toute direction d’acteur. L’amateurisme crasse règne en maître : Anthony Souchet (producteur d’émissions de télévision et conseiller sur les tournées de Mylène Farmer), à qui est attribué le titre de « metteur en scène », se repose totalement sur une scénographie et des jeux de lumières élégants pour faire oublier son terrible manque d’inspiration et de talent.
À quoi bon donner du sens ? À quoi bon donner de la vérité ? À quoi bon faire de l’art ? On se le demande : il fait chanter ses interprètes de dos ; il les fait mourir de façon encore plus risible que Marion Cotillard dans « Batman – The Dark Knight Rises » ; il leur fait feindre de fumer des cigarettes éteintes ; il les plante, stoïques, guitare à la main, à la proue d’un navire de guerre sur les flots déchaînés, et ça ne tangue même pas… ; il les cache en fond de scène derrière des tules trop éclairés, nous donnant à voir une scène nue et immobile pendant les trois quarts de « F… Bocage » ; il touche le fond en se montrant incapable de faire marcher ses comédiennes de façon convaincante lorsqu’elles prennent la route à pieds (personne n’a une démarche aussi grotesque sous le poids de l’exode harassant !).
Il faut même attendre 1h45 de spectacle avant d’apercevoir une scène qui ressemble vaguement à un moment de comédie musicale ! Avec « 2436 Pianos », chanson consacrée aux instruments qui accompagnèrent le débarquement des forces américaines, on s’attend à voir enfin un numéro swing digne de ce genre de spectacle. Las, pour toute chorégraphie, nous aurons une troupe qui tape dans les mains et se fait coucou pendant un (trop) long pont musical. Si seulement ils avaient engagé un chorégraphe…
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_image id= »10593″ size= »full » link_type= »custom_url » link= »# » target= »false » caption= »true » align= »center » margin= »15,25,none,none »]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_text]
Le ridicule ne tue pas
Vous vous attendez à ce que je conclue en vous disant qu’on s’emmerde ferme ? Hé bien, pas tout à fait : on rit. On rit énormément. On rit beaucoup trop, car le ridicule s’invite à chaque instant.
Les arrangements musicaux, marqués profondément par l’empreinte des années 80, sont kitsch à souhait. Leur intros instrumentales sont aussi inutiles qu’interminables.
Les paroles et musiques ont été écrites spécifiquement pour le spectacle ces derniers mois, mais on y retrouve tous les codes éculés des balades molles et ennuyeuses d’il y a trente ans. On a peine à croire que parmi le collectif d’auteurs se trouvent de grands noms talentueux comme Jean-Jacques Goldman (dont le style inspire la majorité de la partition bien qu’il n’en signe que le finale), Charles Aznavour, Alain Chamfort, Maxime Le Forestier ou encore Yves Duteil, parmi 13 autres noms inconnus du grand public.
Les rimes catastrophiques et les saillies poétiques incompréhensibles abondent. Qui peut nous expliquer l’oxymore absurde « Comme les bombes d’un mois d’août en hiver » ? C’est encore pire lorsqu’on comprend les paroles, comme dans « Les Lunettes Cassées » :
« Je suis ce que vous appelez un Bosch
Ce qu’on a fait à la France c’est moche […]
L’angélus sonne dans ma tête
Et en plus, j’ai cassé mes lunettes »
Pourtant, le spectacle se clôt sur « Seulement connu de Dieu », un texte sublime de Claude Lemesle mis en musique par Charles Aznavour, et interprété délicatement par Barbara Pravi. Le final aurait été parfait si l’on n’avait pas à subir en guise de rappel/épilogue le pathétique « Ne m’oublie pas » de Goldman, avec ses onomatopées aberrantes.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_image id= »10594″ size= »full » link_type= »custom_url » link= »# » target= »false » caption= »true » align= »center » margin= »15,25,none,none »]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_text]
Non. Non. Non.
En réalité, on ne rit pas bien longtemps, et l’on ressort de cette mascarade en colère.
Il est révoltant de constater qu’en 2016, des personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’est le théâtre musical produisent encore ce type de spectacle ringard, qui ne joue, sonne, et raconte guère mieux qu’une compagnie amateur sans moyen.
Alors que le talent s’invite de plus en plus souvent sur les scènes françaises pour enfin donner ses lettres de noblesse à un genre boudé par le public, Un Été 44 nous offre un cliché de la comédie musicale telle que nos compatriotes la détestent. Une véritable caricature !
Producteurs, auteurs, compositeurs… ces gens n’ont rien compris au théâtre ni au spectacle musical. Ils n’ont selon toute vraisemblance jamais mis les pieds à Londres, Broadway, ni même Mogador. Ils n’ont rien appris des naufrages artistiques que furent Cindy 2000 ou Adam et Ève. Ils n’ont que faire de saisir le public avec une histoire originale, captivante, émouvante.
Ils ont surtitré en anglais leur « chef d’œuvre », espérant sans doute toucher un public international.
Pour le bien de la réputation naissante de la France parmi les capitales du théâtre musical, espérons que nos amis étrangers ne viendront pas le voir.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_video src= »https://www.youtube.com/watch?v=qstmbuPtZkE » margin= »15,25,none,none »]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col= »12″]
[mp_text]
Réserver
 Un Été 44
Un Été 44
Du 4 novembre au 26 février 2017
Théâtre Comédia
4 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 15h et 20h, le dimanche à 17h
Mise en scène : Anthony Souchet ; idée originale : Sylvain Lebel ; directeur musical : Erick Benzi ; lumières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos.
Chanson écrites et composées par Alain Chamfort, Charles Aznavour, Christian Loigerot, Christian Vié, Claude Lemesle, Erick Benzi, Florent Lebel, François Bernheim, Guy Iachella, Jean Fauque, Jean-Jacques Goldman, Jean-Pierre Marcellesi, Joëlle Kopf, Maxime Le Forestier, Michel Amsellem, Nérac, Sylvain Lebel et Yves Duteil.
Avec : Nicolas Laurent, Sarah-Lane Roberts, Tomislav Matosin, Barbara Pravi, Philippe Krier et Alice Raucoules.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]